Comprendre et aimer un style de vie
Le célibat apostolique
Si la réalité du célibat que nous allons considérer ne se comprend que dans une perspective surnaturelle, le point de vue qui sera développé est majoritairement anthropologique, et en concret psychologique. Les questions à traiter nécessiteront également une approche spirituelle, qui assume celle psychologique. Cette dimension spirituelle se développe grâce à la vie de la grâce, avec les sacrements et la prière, avec l’aide de la direction spirituelle, avec les dons de l’Esprit Saint, etc.
Nous nous inspirons d’une manière spéciale des enseignements que saint Josémaria a largement développés sur l’appel universel à la sainteté, incluant parmi eux les fidèles laïcs qui ont reçu le don du célibat apostolique.
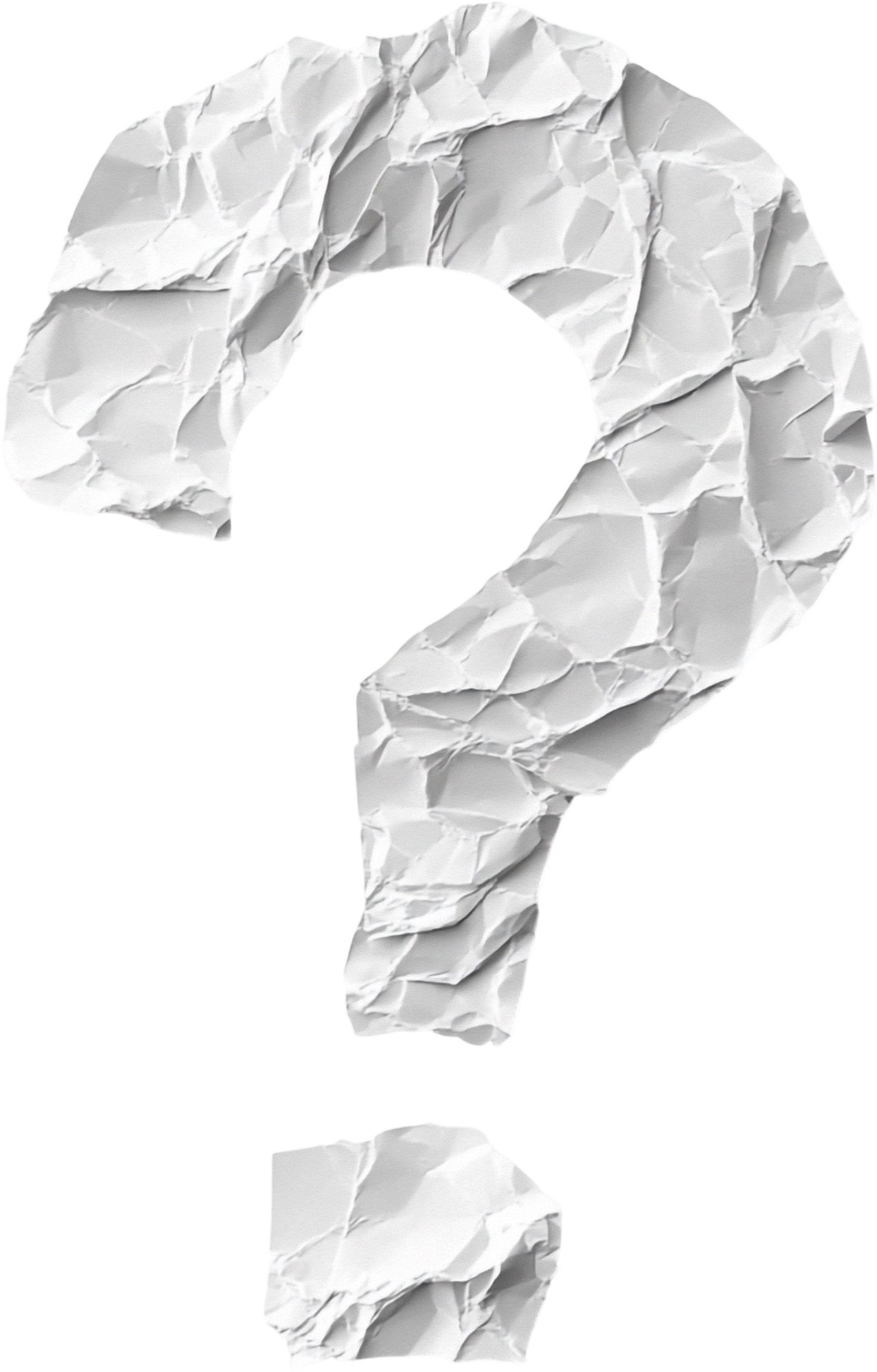
1. Que signifie la vocation des laïcs? Ayant reçu le baptême, je «suis né» laïc, mais y aurait-il un appel à rester laïc?
Étant baptisé, je suis appelé par Dieu à la sainteté et à l’apostolat. Par conséquent, cette vocation – la vocation chrétienne – est la même pour tous ceux qui reçoivent le baptême et elle demeure toujours; c’est le sens le plus profond du mot vocation puisqu’il est marqué par le sceau du sacrement du baptême.
Plus tard, au fur et à mesure que la conscience personnelle de cet appel mûrit, les chemins concrets que Dieu a préparés pour que chacun développe cette grâce baptismale peuvent être découverts intérieurement. Et c’est à ce stade que l’on peut parler de «vocation laïcale» ou de «vocation sacerdotale», ou de «vocation religieuse». Après, dans cette possible vocation laïque, Dieu pourra continuer à montrer à cette personne des chemins: la vocation au mariage, le célibat apostolique, une certaine dédication professionnelle, etc.
2. Quel aspect de la vie du Christ les laïcs imitent-ils ?
Les fidèles laïcs imitent toute la vie de Jésus. Il ne s’agit pas d’une simple imitation extérieure, mais de vivre la vie même du Christ dans son existence ordinaire, qui est le lieu et la matière de leur sanctification et de leur apostolat. C’est pourquoi ils accordent une attention particulière aux années de la vie cachée de Jésus à Nazareth, où ils contemplent le modèle pour sanctifier la famille, le travail et la vie sociale. Mais ces années ne se séparent pas de la vie publique, ni de la Passion, de la Mort, de la Résurrection et de l’Ascension du Seigneur au Ciel, mais, comme Jésus, ils vivent tout cela au quotidien : là ils enseignent la vérité, comme Jésus durant sa vie publique; là, ils portent la croix de chaque jour; là, ils donnent leur vie pour d’autres unis au sacrifice du Calvaire; là, ils vivent la vie du Christ ressuscité et le placent au sommet des activités humaines.
3. Le renoncement au mariage pour les prêtres et les religieux est compréhensible, mais quelle en est la signification chez les laïcs ?
Le célibat est un don spécial que Dieu fait, par lequel il exige l’amour d’un « cœur sans partage, sans la médiation d’un amour terrestre » (Entretiens, n. 122). Son sens, avec cet appel à un amour pour Dieu sans médiation, est de coopérer d’une manière spéciale à la transmission de la vie surnaturelle à d’autres personnes. C’est pourquoi, vécue dans sa plénitude authentique, il génère une paternité ou une maternité spirituelle plus intense. Dieu accorde ce don aussi bien aux laïcs qu’aux religieux ou prêtres, bien qu’avec une signification spécifique dans chaque cas.
Le célibat apostolique est un don que Dieu accorde à certaines personnes pour s’unir plus intimement au Christ et coopérer de manière spéciale avec lui dans sa mission salvifique, mettant en pratique le sacerdoce commun (dans le cas des laïcs) ou le sacerdoce commun et ministériel (dans le cas des ministres ordonnés). Dans le cas des religieux, le célibat est au service de leur mission spécifique, qui est de témoigner que la fin du chrétien est le Royaume des Cieux, où « ils ne se marieront ni ne seront donnés en mariage », comme on le lit dans l’Évangile de Saint Marc. Ils rendent ce témoignage à travers un état de vie consacrée par les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, avec une vie de dévouement à l’amour de Dieu et d’aide aux autres qui comporte une certaine séparation du monde, c’est-à-dire des réalités professionnelle, familiale et sociale. Même s’ils peuvent exercer certaines professions, par exemple, dans le domaine de l’éducation ou de l’assistance, leur mission n’est pas de sanctifier le monde à l’intérieur de ces réalités, comme dans le cas des laïcs, mais par leur consécration religieuse.
4. Saint Josémaria, par exemple, a eu clair à l’esprit dès le début la spécificité de l’appel du laïc au célibat, sans la nécessité d’une consécration autre que celle du baptême. Pourquoi est-ce parfois difficile à comprendre dans le monde ecclésial ?
La première Lettre aux Corinthiens témoigne que parmi les premiers chrétiens, il y avait ceux qui avaient reçu le don du célibat pour le Royaume des Cieux. De même, les Pères de l’Église de la fin du 1er et du début du 2e siècle, comme saint Clément Romain et saint Ignace d’Antioche, parlent de ceux qui reçoivent le don du célibat, et ne mentionnent pas qu’ils ont fait une consécration autre que celle du baptême. Très important est le témoignage de saint Justin qui, au milieu du IIe siècle, affirme que de nombreux chrétiens, hommes et femmes, sont restés célibataires et souligne qu’ils sont des fidèles communs.
Aux 3e et 4e siècles, on parle de « vierges consacrées », qui accomplissent une consécration publique et mènent un état de vie particulier. Certains Pères de l’Église les appellent « épouses du Christ ». Plus tard, l’état de vie consacrée a commencé à être vécu dans les monastères et plus en avant dans les ordres religieux et les congrégations [1].
On pourrait insister sur le fait que la compréhension du célibat chez les laïcs va de pair, entre autres, avec la compréhension du même appel universel à la sainteté. Quiconque connaît l’histoire de la théologie sait bien que la doctrine sur ces points est encore à l’état embryonnaire, même après le Concile Vatican II. Dans cette situation, il n’est pas surprenant qu’il puisse encore être difficile de comprendre qu’il existe des laïcs qui recherchent la sainteté de toute leur âme, qui veulent être contemplatifs au milieu du monde, et que certains d’entre eux reçoivent le don du célibat.
5. Pourquoi parle-t-on du célibat apostolique ? En quoi est-il similaire et en quoi diffère-t-il des autres formes de célibat dans l’Église ?
Le don du célibat est toujours apostolique, que ce soit pour les ministres sacrés, les religieux que pour les laïcs. Mais dans chaque cas, ce célibat est « apostolique » d’une manière différente, selon la mission de chacun. Chez les fidèles laïcs, le célibat apostolique est au service de la mission de sanctifier le monde dans la vie professionnelle, familiale et sociale. Le don du célibat les conduit à se donner à Dieu sans partage pour se consacrer « aux choses du Seigneur », comme le dit saint Paul.
Saint Josémaria réserve généralement l’expression « célibat apostolique » pour désigner les laïcs qui ont été appelés sur ce chemin. On comprend qu’il ne dit pas simplement « célibat » mais ajoute « apostolique », car il veut le distinguer de l’état civil de célibataire sans motivation d’amour de Dieu. On comprend également que lorsqu’il parle du célibat des ministres sacrés ou réligieux, il n’ajoute pas «apostolique» car ces formes de célibat sont généralement désignées comme «célibat sacerdotal» ou «célibat consacré», expressions qui incluent déjà la dimension apostolique.
En général, le célibat apostolique des laïcs a en commun avec le célibat sacerdotal des ministres ordonnés et avec le célibat consacré des religieux, l’appel à se donner à Dieu et aux âmes avec un cœur sans partage. D’un autre côté, dans le cas spécifique de l’Opus Dei, le célibat apostolique des laïcs se caractérise par le fait d’être au service de la mission laïque de sanctifier le monde de l’intérieur (ce qui est typique de tout laïc qui reçoit ce don) et parce qu’il est vécu avec l’esprit spécifique de l’Opus Dei et ses propres modes apostoliques.
6. Si la caractéristique des laïcs est de sanctifier le monde de l’intérieur, être célibataire ne sépare-t-il pas en quelque sorte du monde?
Le célibat apostolique ne sépare pas du monde tout comme celui qui décide de ne pas se marier pour n’importe quel motif humain ne se sépare du monde. Dans le cas du célibat pour le Royaume des Cieux, le motif est l’amour de Dieu et des âmes. D’autres peuvent ne pas se marier pour des raisons nobles, comme prendre soin de leurs parents ou se consacrer à une tâche de service à la société, et cela ne les sépare pas du monde. D’autres, enfin, peuvent ne pas le contracter pour des raisons égoïstes, mais cela n’implique pas non plus le retrait du monde.
En ce sens, ceux qui vivent le célibat apostolique non seulement ne se retirent pas du monde, mais peuvent se sentir pleinement dans le monde, car ce don est accueilli pour contribuer à la sanctification du monde de l’intérieur.
7. Une personne célibataire peut-elle réaliser pleinement sa féminité ou sa masculinité ?
Une personne peut mener une vie pleine et fructueuse, en vivant le célibat. « Avec le célibat, rien de l’humain n’est perdu. Les notes essentielles de la masculinité ou de la féminité brillent d’une nouvelle manière » (W. Vial, Psicología y Celibato, p. 146).
Une riche affectivité est compatible avec le don à Dieu dans le célibat. Il serait erroné de penser que l’affectivité doit être «sacrifiée» devant un bien plus grand qui est le don complet et exclusif à Dieu. Cette tendance trouve peut-être son origine dans une certaine conception stoïcienne de la vie chrétienne ou dans l’identification de l’affectivité à la sexualité, qui est un réductionnisme.
Considérer qu’une personne célibataire ne peut pas atteindre un équilibre affectif, ou que l’état matrimonial est émotionnellement et mentalement plus sain, c’est en quelque sorte envisager que la personne elle-même est incomplète et qu’elle doit combler cette lacune avec l’autre sexe et exercer la sexualité pour atteindre la plénitude.
Chaque personne est complète en tant que personne, ce qui n’empêche pas que, pour se réaliser pleinement, elle a besoin de Dieu et des autres et, par conséquent, de ses relations avec les hommes et les femmes. Mais ces relations, bien qu’elles soient toujours entre personnes sexuées (hommes et femmes), n’ont pas besoin d’être sexuelles.
L’affectivité sexuée n’est donc pas liée à la sexualité et à son usage, mais à l’amour. La personne ne peut pas vivre sans amour, car sa vocation consiste à aimer : avoir de bonnes relations avec les autres, se donner aux autres. En ce sens, chaque personne atteint sa plénitude à travers une vie donnée aux autres. Pour cette raison, l’amour intègre la totalité de la personne : tendances, désirs, affections, intelligence-volonté, l’agir et les relations personnelles. En fin de compte, l’amour intègre personnellement la féminité et la masculinité dans ses diverses manifestations physique, mentale et spirituelle. Pour cette raison, la réalisation personnelle de sa propre féminité ou masculinité n’exige pas nécessairement le niveau physico-biologique, pas même la conjugalité, la paternité-maternité ou la création d’une famille humaine, mais tend plutôt vers la communion personnelle.
Le mariage est une manière de réaliser cette communion, mais pas l’unique. Il existe différentes manières de procéder. Pour certaines personnes, la vocation à l’amour ne passe pas par le mariage, mais se réalise sans aucune médiation d’un mari ou d’une femme. Cela explique aussi pourquoi l’amour conjugal ne se termine pas en lui-même, il doit toujours être ouvert à la communion avec Dieu et avec les autres. C’est pourquoi le mariage, lorsqu’il est vrai, est toujours un chemin vers et non un but. Le but est toujours la plénitude de l’amour, qui ne se trouve qu’en Dieu.
Quand Jésus parle du mariage à ses contemporains, après avoir rappelé l’enseignement de la Genèse, il va plus loin. Le Seigneur parle de ceux qui, par un don spécial, sont capables de renoncer au mariage « pour le Royaume des Cieux » (Mt 19, 12). Jésus lui-même a parcouru ce chemin, car il est resté célibataire. Il n’avait besoin d’aucune médiation : « le Père et moi sommes un » (Jn 10, 30). Et non seulement il l’a parcouru, mais il est lui-même le Chemin pour beaucoup d’autres personnes pour trouver l’amour total de Dieu. Ainsi, « la virginité et le mariage sont, et doivent être, des manières différentes d’aimer, » parce que l’homme ne peut pas vivre sans amour « » [2].
8. Les célibataires limitent-ils leur richesse affective ?
Tout d’abord, il faut dire ce que l’on entend par affectivité. Avec ce terme, nous nous référons à la capacité de vivre intimement les réalités externes, les événements, les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, les relations avec les autres et avec nous-mêmes. Bref, c’est la capacité que nous avons de « nous sentir touchés » par ce qui nous entoure, de vibrer avec le monde et les gens, de nous laisser interpeller par la réalité. Les célibataires ne limitent pas leur richesse affective lorsqu’ils aiment: lorsqu’ils sont capables d’accepter et même d’aimer la réalité telle qu’elle est, sans l’idéaliser et sans la dénigrer. En ce sens, l’intégration de la sexualité est fondamentale pour parler d’une affectivité riche et mature. En effet, pour l’intégrer, il ne suffit pas de connaître, de retenir et de s’approprier la dynamique physique, physiologique, psychologique et spirituelle de la sexualité, c’est-à-dire de la personnaliser, mais surtout il faut exprimer à travers elle le don de soi à Dieu et aux autres. Un don qui est toujours une réponse à l’appel que le célibataire et le marié reçoivent de Dieu. Pour cette raison, le célibat ne consiste pas seulement en continence, annulation des désirs ou simple maîtrise de soi, mais en un don qui doit être demandé avec humilité et constance.
Les gens qui vivent le célibat apostolique accueillent avec gratitude le don de l’amour de Dieu dans leur vie, et essaient d’en prendre soin afin que rien ne le ternisse ou ne le fasse perdre son éclat. Pour ce faire, ils aiment Dieu et les autres avec un cœur humain, le seul que nous ayons, ils prennent soin des autres avec tendresse et charité, leur montrant ainsi, avec leur propre vie, l’amour que Dieu a pour eux. En se laissant aimer entièrement par le Seigneur, ils peuvent donner aux autres l’amour qu’ils reçoivent. Et, se donnant exclusivement au Christ et sachant qu’Il les envoie au peuple – aux personnes spécifiques qui les entourent – ils essaient de remplir le monde de Son même Amour. La différence avec les personnes mariées ne se réfère donc pas à l’amour, mais aux relations conjugales et familiales, ainsi que l’affectivité qui y est liée, puisqu’elles dépendent de l’amour humain, c’est-à-dire entre un homme et une femme.
9. L’apostolat est-il un moyen de développer une maternité / paternité spirituelle ?
Tout d’abord, il faut spécifier ce que l’on entend par « maternité spirituelle » (ou « paternité spirituelle »). Saint Jean, dans le premier chapitre de son Évangile, parle d’une naissance de la chair et du sang, qui est la naissance de la vie naturelle, et d’une naissance «de Dieu » qui est la naissance de la vie surnaturelle. La «maternité spirituelle» se réfère à cette dernière : c’est la maternité de celui qui a été un instrument pour communiquer la vie surnaturelle à un autre, coopérant avec l’Esprit Saint, source de cette Vie (c’est pourquoi c’est «la vie spirituelle »). En ce sens, Saint Paul appelle les Galates « ses enfants » parce que Dieu l’a utilisé pour leur communiquer cette vie.
Le célibat apostolique conduit à coopérer de manière spéciale avec le Saint-Esprit pour communiquer la vie surnaturelle aux autres ou pour la faire grandir en eux, et c’est pour cette raison qu’il est une source de maternité spirituelle. Cela se produit dans l’apostolat quand on coopère à la naissance d’un autre à la vie spirituelle (par exemple, aider une personne à se faire baptiser); ou aussi et plus fréquemment en coopérant à ce qu’une personne puisse récupérer dans le sacrement de Pénitence la vie surnaturelle qui avait été perdue à cause du péché mortel; ou en aidant quelqu’un à grandir en vie surnaturelle; et surtout en collaborant avec le Saint-Esprit pour qu’une autre personne découvre le chemin de sainteté sur lequel Dieu l’appelle. Tout ce qui précède fait partie de l’apostolat.
10. La personne qui vit le célibat apostolique le fait simplement pour être plus disponible, pour avoir plus de temps pour se consacrer à l’œuvre apostolique ?
Le célibat n’est pas seulement une question de disponibilité « matérielle », en termes quantitatifs, comme s’il était justifié par des raisons d’efficacité : pour réaliser certains travaux d’apostolat, il faudrait ne pas avoir d’autres engagements. Cette approche est réductrice.
Il s’agit plus de la « disponibilité » du cœur : avoir un cœur avec la liberté effective de ne vivre que pour Dieu et, à travers Lui, pour les autres, pour toutes les âmes [3]. Ceci est possible parce que le célibat apostolique est une motion spéciale et un don de Dieu. « Le célibataire s’inquiète des choses du Seigneur, comment plaire au Seigneur» (1 Co 7, 32). Il n’ignore pas ses égaux au milieu du monde, au contraire : les choses du Seigneur sont les autres personnes, pour lesquelles il offre sa vie.
Benoît XVI a évoqué ce point en parlant du célibat des ministres sacrés, mais ses paroles peuvent aussi s’appliquer au célibat apostolique des laïcs : « Les raisons purement pragmatiques, la référence à une plus grande disponibilité, ne suffisent pas » ; le célibat « doit signifier plutôt se laisser emporter par l’amour de Dieu et ensuite, par une relation plus intime avec lui, apprendre aussi à servir les hommes » [4].
11. En el caso concreto del Opus Dei, ¿cómo se explica que sus fieles, tanto los casados como los célibes, compartan la misma vocación, si desde el punto de vista teológico, el celibato es superior al matrimonio?
L’Église soutient que le célibat est, d’une certaine manière, un appel plus élevé que le mariage. Cela tient à plusieurs raisons : l’identification au Christ également dans cet aspect particulier de sa vie sur terre, la supériorité de la paternité et de la maternité spirituelles par rapport aux êtres humains [5], l’impulsion de foi qui nécessite de se lancer dans une fertilité surnaturelle, entre autres. Cependant, « pour chacun, la chose la plus parfaite est – toujours et seulement – de faire la volonté de Dieu » [6]. Par conséquent, aucune des deux voies n’est automatiquement plus sainte ni plus efficace apostoliquement.
Compte tenu du fait que la vocation à l’Opus Dei inclut l’appel à la sainteté et à l’apostolat dans sa propre situation – c’est l’essentiel de la vocation à l’Œuvre -, on comprend que l’on peut la vivre à la fois dans le mariage et dans le célibat.
12. Qu’est-ce qui peut entraver la maturation psychique ou un développement sain de la personnalité ?
Il est difficile d’établir la limite entre santé et maladie, mais on peut dire que, dans le cas de la santé mentale, cela est lié à un critère adéquat d’acceptation de la réalité sans distorsions, avec un développement harmonieux de la personnalité, avec une attitude adéquate face à soi-même (connaissance de soi, acceptation de soi, maîtrise de soi) et avec une bonne adaptation à l’environnement et aux difficultés et situations de conflit.
Des facteurs génétiques, familiaux, comportementaux et sociaux influencent l’apparition d’une maladie mentale. Par exemple, le déséquilibre affectif chez une personne auparavant en bonne santé peut survenir lorsqu’elle prend une décision qui affecte toute son existence et, néanmoins, continue à vouloir, désirer, regretter ce qu’elle laisse. Il y a donc rupture de la personnalité. Par conséquent, la santé mentale et émotionnelle n’est pas liée au célibat ou à la vie conjugale, mais à certains des facteurs mentionnés ci-dessus.
13. Peut-on atteindre un équilibre mental et émotionnel en étant célibataire ?
Les concepts de « maturité ou équilibre affectif » et de « santé psychique ou équilibre mental » sont des concepts dynamiques. Nous ne pouvons jamais garantir qu’une certaine pathologie ne puisse apparaître à un moment donné. Face à de nouvelles situations nécessitant des comportements d’adaptation, il existe toujours un risque de décompensation (anxiété, dépression, trouble du comportement, etc.)
Cependant, si une personne tout au long de sa vie acquiert et développe certaines capacités telles que la connaissance de soi, l’acceptation de sa propre réalité (sa biographie, sa situation personnelle, familiale et sociale), un projet de vie personnel réaliste, la capacité d’avoir un comportement cohérent adapté à la réalité, avec des buts et objectifs réalistes et concrets, et la capacité d’établir des relations affectives stables, elle sera en mesure d’atteindre un équilibre mental et affectif qui lui permettra d’orienter sa propre vie vers le but qu’elle s’est proposé.
Pour qu’il y ait équilibre mental et affectif, lorsqu’une personne décide d’emprunter la voie du célibat, elle doit être consciente qu’elle a mis de côté d’autres options et que cette décision implique tous les aspects de sa personnalité, ainsi que ses désirs, affections et projets, pour toute la vie. Elle n’a pas à les cacher, à les mettre de côté ou à les faire taire, mais à les mettre au service de Dieu, qu’elle a choisi avec un amour exclusif, et elle doit lutter toute sa vie pour que tous ses amours terrestres soient informés et tournent autour de son grand amour et qu’ainsi ceux-ci ne deviennent pas un obstacle.
La maturité affective est importante chez une personne célibataire, pas nécessairement comme point de départ ou comme accomplissement définitif, car en tout – y compris dans l’intégration affective et sexuelle – on peut grandir, mais plutôt comme une tâche dans laquelle il faut s’efforcer pour pouvoir aimer Dieu de tout son cœur et de toute ses forces.
Dans tous les cas, pour atteindre cet équilibre, la personne doit « aimer et se sentir aimée». Pour y parvenir, il est généralement très utile d’avoir un large éventail de relations humaines et sociales, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de sa famille ou institution.
14. De quelles caractéristiques faut-il tenir compte au moment de discerner si une personne est en mesure de recevoir le don du célibat?
15. Y a-t-il des caractéristiques de «risque» dont nous devrions tenir compte lors du discernement?
16. Y a-t-il des considérations féminines spécifiques dont il faut tenir compte dans le discernement vocationnel des femmes?
17. Une personne en manque de maturité émotionnelle, causée par l’absence de parents (manque de proximité pendant l’enfance et l’adolescence, séparation, divorce, remariage, etc.) peut-elle être guidée, si elle voit que Dieu l’appelle, au célibat? Cette lacune «affective» peut-elle être comblée, ou vaut-il mieux la faire attendre et la diriger vers le mariage?
18. La dépendance affective, est-elle une question d’éducation? Cela peut-il avoir des conséquences majeures dans un appel au célibat?
19. Une personne, par le simple fait de vivre le célibat, aurait-elle besoin d’une plus grande résilience psychologique, ou surtout de renforcer certaines vertus? Comment répondre aux besoins émotionnels des personnes données à Dieu?
En psychologie, la résilience est comprise comme la capacité d’une personne à s’adapter, à faire face et à surmonter des circonstances défavorables. Peut-être que pour vivre le célibat, une plus grande résilience est nécessaire, mais cela dépend, comme dans la plupart des choses, de chaque personne. Il peut être utile de tenir compte du fait que la tolérance à la frustration (comprise comme la capacité à endurer des expériences négatives sans se décourager ou souffrir de manière disproportionnée sur le plan émotionnel) et la résilience sont plus ou moins développées chez chaque personne en fonction de ses réactions émotionnelles avant la souffrance, qui dépendent, à leur tour, à la fois des messages et des exemples donnés par ses parents et éducateurs, et de sa sensibilité émotionnelle naturelle, qui est génétiquement déterminée.
Quant aux autres vertus nécessaires au célibat, peuvent être mises en évidence: une plus grande prudence dans les relations avec les personnes de l’autre sexe, la sincérité et la force pour ne pas se laisser dominer par la curiosité: l’inconnu produit généralement une forte attirance, et il est facile pour les personnes peu matures de céder à la tentation.
Quant aux «vides» émotionnels, il est essentiel de garder à l’esprit que ce qui rend vraiment heureux est la capacité d’aimer et cela peut être pleinement développé à la fois dans le célibat et dans la vie conjugale. Par conséquent, on ne peut pas être heureux sans aimer et sans se sentir aimé. La présence de situations dans lesquelles on se sent «vide» sur le plan émotionnel peut se produire dans une situation comme dans l’autre.
Une personne mariée peut également éprouver des «vides» émotionnels, des «lacunes» après une rupture, une perte ou un éloignement: un enfant qui part, le décès du mari, la déception d’un ami, la séparation entre les conjoints qui peut survenir avec le passage du temps si la relation entre les deux n’est pas soignée, etc. Une personne qui aime, même pleinement aimante, souffre aussi, vit des expériences douloureuses qu’elle ne peut éviter. L’important est de trouver le sens de cette souffrance.
Peut-être est-il utile de considérer que la sphère affective d’une personne se développe, s’enrichit et grandit tout au long de sa vie. En ce sens, le noyau familial est fondamental et constitutif pour les affections, mais non absolu ou définitif. L’affectivité doit continuer à grandir, à mûrir (comme les autres dimensions personnelles) et pour ce faire elle a besoin des autres. Contrairement à l’intelligence qui peut se développer en lisant et en étudiant des livres, l’affectivité ne le peut pas: il ne suffit pas de savoir, il faut vivre, vivre ce que je sais et ressens (je peux tout savoir sur l’amour, mais je ne serai une personne heureuse que si j’aime quelqu’un et si je me sens aimé par ce dernier). Et dans ce sentiment, je ne peux pas être seul, j’ai besoin de l’autre; les affections ont une dimension relationnelle.
Enfin, par rapport aux autres, il serait possible d’apporter des précisions sur le concept, parfois utilisé dans le contexte des réalités ecclésiales, d’ « amitié particulière », car, à certaines occasions, une idée fausse pourrait être intériorisée qui entraînerait la rupture de liens enrichissants avec d’autres personnes proches ou de la même institution de l’Église. À cet égard, en synthétisant beaucoup:
– Ce serait une «mauvaise amitié particulière» (et donc, préjudiciable à la personne): un traitement exclusif ou fréquent, éprouver de la jalousie lorsque l’autre personne est avec des tiers, intimités (choses physiques ou personnelles dont il n’est pas approprié de parler avec cette personne), relation fermée au sein de laquelle personne d’autre n’entre, chuchotements, critiques, murmurations.
– Ce ne serait pas une «mauvaise amitié particulière»: se rendre compte qu’il y a une personne avec qui on a une affinité particulière et beaucoup de choses en commun, et donc on passe plus de temps avec elle sans avoir à dépendre de sa présence pour être bien émotionnellement. En définitive, un critère permettant de les distinguer est de savoir si cette amitié est exclusive d’autrui ou, au contraire, si elle est inclusive, ouverte aux autres.
20. La société d’aujourd’hui dans de nombreux pays favorise les traits perfectionnistes. Personne n’est à l’abri et l’éducation de l’affection est importante pour les personnes célibataires depuis des années dévouées à Dieu, comme pour tant de jeunes. Comment distinguer un «perfectionnisme» qui peut être supprimé avec la formation, d’un perfectionnisme qui est un risque pour le célibat?
Considération finale sur le célibat apostolique:
D’après ce qui a été expliqué dans les différentes réponses, il semble approprié que les formateurs et ceux qui aident au discernement sur le célibat aient une connaissance suffisante de la psychologie évolutionniste, ce qui permet de détecter les manifestations de normalité dans le contexte socioculturel plus large dans lequel se trouve les personnes. Ainsi, une distinction peut être faite entre ce que les gens font par éducation ou par manque d’éducation, surtout lorsque ce qu’ils font contraste avec ce qui est vécu dans d’autres cultures, et des défauts personnels de type de tempérament ou de caractère.
L’homme et la femme ont une série de caractéristiques propres qui leur permettent de se compléter. De fait, cela donne naissance à la variété et à la richesse de la famille humaine. Cependant, cette complémentarité n’implique pas un manque de plénitude chez les personnes de chaque sexe: à la racine de la diversité sexuelle dans laquelle se modélise l’être humain se trouve l’unité de chaque personne singulière; chaque homme et chaque femme sont des personnes dans leur ensemble.
En ce sens, les hommes et les femmes sont appelés à une plénitude qui s’obtient en vivant selon cette condition personnelle; Cela se manifeste surtout dans l’exercice harmonieux de la capacité d’établir une relation d’amitié avec Dieu et d’amour réciproque avec les autres êtres humains et de prendre soin du reste du monde créé.
On comprend alors que l’épanouissement personnel n’implique pas nécessairement la conjugalité, bien qu’il soit nécessaire à la continuité des hommes sur terre; il exige, au contraire, le don de soi-même. De fait, Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, se donne à tous, vivant le célibat sur cette terre. En d’autres termes, le célibat fait partie de la perfection divine et humaine incarnée du Fils de Dieu, modèle de tout être humain, homme et femme, dans le temps et dans l’éternité.
———————————
[1] cfr. Instruction « Ecclesiae Sponsae Imago » sur « l’Ordo virginum », 8-VI-2018, nn. 1-5.
[2] Francisco, Exh. Ap. Amoris laetitia, 19 mars 2016, n. 161. La citation interne est de Jean-Paul II, Lettre enc. Redemptor hominis, 4 avril 1979, n. dix.
[3] En ce sens on peut lire, par exemple, l’explication que font les Statuts de la Prélature de l’Opus Dei sur les différentes modalités d’appartenance en termes de disponibilité: «Selon la disponibilité habituelle de chacun à se consacrer aux tâches de formation et à certaines tâches apostoliques de l’Opus Dei, les fidèles de la Prélature, hommes ou femmes, sont appelés Numéraires, Agrégés ou Surnuméraires, sans former de classes différentes. Cette disponibilité dépend des circonstances variées et permanentes – personnelles, familiales, professionnelles ou autres analogues – de chacun » (Statuta, n. 7 § 1).
[4] Benoît XVI, Discours à la Curie romaine, 22-XII-2006.
[5] Cf. Saint Josémaria, Quand le Christ passe, n. 55.
[6] Saint Josémaria, Entretiens, n. 92. En ce sens, les Statuts de la Prélature de l’Opus Dei affirment que tous les fidèles se donnent au service de Jésus-Christ «avec un plein dévouement» (Statuta, n. 87 § 1), chacun selon les circonstances de sa propre vie.
Cultivando Humanidad
